| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
Horatius
Animateur
Inscrit le: 11 Apr 2008
Messages: 695
|
 écrit le Saturday 27 Apr 13, 18:37 écrit le Saturday 27 Apr 13, 18:37 |
 |
|
décrépit : "Dont l'âge a fortement altéré la vigueur physique et même parfois les forces morales, intellectuelles" (TLFi)
Le mot est attesté en ancien français dès le XIIe siècle. On le retrouve de façon tout à fait identique (decrépito) en italien et en espagnol. En latin, decrepitus a exactement le même sens dans les quelques attestations qu'on lui trouve (Plaute, Cicéron...).
Le sens est clairement métaphorique, mais il n'est pas si évident que cela d'expliquer cette métaphore. Et ce qui a attiré mon attention sur ce mot, c'est justement la variété avec laquelle on explique cette métaphore.
Le mot est formé du préfixe de- et de crepitus, participe de crepare:
crepare : craquer, pétiller; se dit de tout ce qui se fend ou éclate avec bruit, notamment du bois, par suite "se fendre, se rompre" (Ernout Meillet)
Michel Bréal a supposé que "la vieillesse décrépite est comparée à un mur qui se lézarde, ou à un arbre qui se fend."
Cependant, le préfixe de- (qui marque d'habitude le manque, la cessation) pose problème : on pourrait alors supposer qu'il marquerait ici l'achèvement.
En fait, ce sens métaphorique est également attesté, à l'époque tardive, avec le simple crepare, employé pour des êtres vivants au sens de mourir :
Ad quam (Semelem) cum fulmine veniens (Juppiter), illa crepuit.
Quand Jupiter apparut à Sémélé avec son foudre, elle mourut. (Hygin, fabulae)
Ce sens se retrouve dans l'italien crepare, comme dans le français crever.
Autre interprétation moderne de la métaphore, celle de Walde, qui rapproche cette expression d'une autre : "animam ebullire" (ebullire : bouillonner) : rendre l'âme (expression attestée chez Sénèque et Perse, notamment).
Il faudrait ainsi rapprocher l'idée de crépiter, de pétillement, et celle de bouillonnement
Dans l'Antiquité, des interprétations populaires différentes étaient données pour expliquer ce mot. Festus en donne deux, coup sur coup :
decrepitus est desperatus crepera jam vita, ut crepusculum extremum diei tempus. Sive decrepitus dictus, quia propter senectutem nec movere se, nec ullum facere potest crepitum.
Est décrépit celui qui n'a plus rien à espérer d'une vie déjà assombrie, comme le crépuscule est le dernier instant du jour. Ou bien, on dit qu'un homme est décrépit, parce que, à cause de son âge, il ne peut plus bouger et ne peut plus faire de bruit.
Isidore de Séville en suggère une autre un peu différente:
quod iam crepare desierit, id est loqui cessauerit
parce qu'il a cessé de se faire entendre, c'est-à-dire de parler.
La 1ère interprétation de Festus ne rattache pas decrepitus à crespo mais à creper, via crepusculum (creper = obscur, douteux : le crépuscule est le moment incertain entre jour et nuit). Elle explique de- par référence à desperatus (déspespéré)
La 2e interprétation de Festus et celle d'Isidore rattachent bien decrepitus à crepare, mais en expliquant la métaphore différemment de Bréal, ce qui offre au moins l'avantage de donner son sens habituel au préfixe de- : de - (cessation) + crepitum (au sens de bruit ou au sens de parler)
Mais il n'y a pas que dans l'Antiquité que des étymologies populaires se sont développées autour de ce mot.
Dans la représentation commune, "décrépit" est associé au verbe "décrépir", qui n'a pourtant aucun lien étymologique originel.
Saussure signale ce phénomène d'étymologie populaire : "Aujourd'hui, il est certain que la plupart des personnes voit un rapport entre un mur décrépi et un homme décrépit".
Le verbe "décrépir : Enlever le crépi d'un mur" n'est cependant attesté par les dictionnaires que depuis le XIXe siècle. Le verbe crépir et son doublet crêper expriment l'idée de froncer, friser, onduler (latin crispare) : le premier a été utilisé, entre autres, dans le domaine de la tannerie avant de finir par se spécialiser dans le domaine de la maçonnerie (crépir, c'est enduire un mur d'une couche de mortier, sans la lisser) ; le second sert dans le domaine du textile (cf un crêpe) et dans celui de la coiffure (cf crépu). Quant à la crêpe (que l'on mange), son nom est une allusion à l'aspect ondulé qu'elle prend en cuisant.
Bref, résumons-nous :
- décrépit vient de crepare (craquer). Mais l'interprétation métaphorique n'est pas évidente
- Une étymologie populaire antique rattachait décrépit à creper (obscur).
- Une étymologie populaire actuelle tend à rattacher décrépit à crispare (onduler).
Ce dernier rattachement est presque officialisé par certains emplois littéraires. Ainsi, Huysmans, dans Les Soeurs Vatard, écrit :
"Tous ces amours au débotté lui décrépissaient la face"
On est bien là dans la métaphore de la maçonnerie, mais pour exprimer l'idée de déchéance physique et morale, que contient l'adjectif décrépit ! |
|
|
|
 |
Papou JC
Inscrit le: 01 Nov 2008
Messages: 11192
Lieu: Meaux (F)
|
 écrit le Saturday 27 Apr 13, 21:26 écrit le Saturday 27 Apr 13, 21:26 |
 |
|
| Y a-t-il beaucoup d'autres verbes latins du premier groupe (-are) qui font leur participe en -itus alors que la majorité le font en -atus ? |
|
|
|
 |
rejsl
Animatrice
Inscrit le: 14 Nov 2007
Messages: 3671
Lieu: Massalia
|
 écrit le Saturday 27 Apr 13, 21:43 écrit le Saturday 27 Apr 13, 21:43 |
 |
|
 l'allemand a le verbe krepieren issu de l'italien crepare , entré en allemand au 17eme siècle via le jargon des soldats. Signifie crever et s'emploie pour les animaux ou pour les hommes s'il s'agit d'une mort misérable. l'allemand a le verbe krepieren issu de l'italien crepare , entré en allemand au 17eme siècle via le jargon des soldats. Signifie crever et s'emploie pour les animaux ou pour les hommes s'il s'agit d'une mort misérable. |
|
|
|
 |
Horatius
Animateur
Inscrit le: 11 Apr 2008
Messages: 695
|
 écrit le Sunday 28 Apr 13, 10:08 écrit le Sunday 28 Apr 13, 10:08 |
 |
|
| Papou JC a écrit: | | Y a-t-il beaucoup d'autres verbes latins du premier groupe (-are) qui font leur participe en -itus alors que la majorité le font en -atus ? |
Dans sa morphologie, Ernout donne une courte liste de ces verbes où la voyelle -ā- n'apparaît qu'au présent : exemples pris parmi les plus fréquents :
- domo, as, are, domui, domitum : dompter
- sono, as, are, sonui, sonitum : sonner
- veto, as, are, vetui, vetitum : interdire
- et, avec élision de la voyelle au participe : seco, as, are, secui, sectum : couper |
|
|
|
 |
Papou JC
Inscrit le: 01 Nov 2008
Messages: 11192
Lieu: Meaux (F)
|
 écrit le Sunday 28 Apr 13, 12:06 écrit le Sunday 28 Apr 13, 12:06 |
 |
|
| Merci ! En général, dans ces cas-là, on imagine une fusion de deux radicaux différents, non ? |
|
|
|
 |
Horatius
Animateur
Inscrit le: 11 Apr 2008
Messages: 695
|
 écrit le Sunday 28 Apr 13, 13:53 écrit le Sunday 28 Apr 13, 13:53 |
 |
|
Le radical verbal est le même, c'est crep-
Simplement, la voyelle thématique -ā- ne s'y ajoute qu'au thème du présent.
C'est un phénomène plus fréquent quand il s'agit d'une voyelle thématique -ē- (verbes de deuxième conjugaison) qui n'apparaît souvent qu'au thème de l'infectum :
- candeo / candui
- iaceo / iacui
- habeo / habui
...
Je préfère ne pas trop en dire sur tout cela, car je ne suis pas linguiste et j'aurais peur de dire des imprécisions. |
|
|
|
 |
José
Animateur
Inscrit le: 16 Oct 2006
Messages: 10945
Lieu: Lyon
|
 écrit le Tuesday 01 Apr 14, 11:20 écrit le Tuesday 01 Apr 14, 11:20 |
 |
|
- (In a statement late Monday, it said the final words received by ground controllers at 1:19 a.m. on March 8 were “Good night Malaysian three-seven-zero.” Earlier the government said the final words were “All right, good night.”) The statement didn’t explain the discrepancy.
= (Le gouvernement malaisien a donné 2 versions concernant les derniers mots des pilotes) Le communiqué n'explique pas la divergence (= entre les 2 versions).
[ The NY Post - 01.04.2014 ]
 discrepancy discrepancy
- divergence - désaccord - contradiction - opposition
| etymonline a écrit: |
discrepancy (n.)
mid-15c. (discrepance), from Latin discrepantia "discordance, discrepancy,"
from discrepantem (nominative discrepans), present participle of discrepare "sound differently, differ,"
from dis- "apart, off" (see dis-) + crepare "to rattle, crack." |
 discrepanza discrepanza
- discordance
- différence
discrepare
- (rare - littéraire) discorder - différer |
|
|
|
 |
Xavier
Animateur
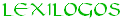
Inscrit le: 10 Nov 2004
Messages: 4087
Lieu: Μασσαλία, Prouvènço
|
 écrit le Saturday 29 Jun 19, 12:30 écrit le Saturday 29 Jun 19, 12:30 |
 |
|
| En ancien français : discrépance : désaccord, discordance, divergence, différence (Godefroy) |
|
|
|
 |
Papou JC
Inscrit le: 01 Nov 2008
Messages: 11192
Lieu: Meaux (F)
|
 écrit le Saturday 29 Jun 19, 15:51 écrit le Saturday 29 Jun 19, 15:51 |
 |
|
| Horatius a écrit: | décrépit : "Dont l'âge a fortement altéré la vigueur physique et même parfois les forces morales, intellectuelles" (TLFi) [...]
Le sens est clairement métaphorique, mais il n'est pas si évident que cela d'expliquer cette métaphore. Et ce qui a attiré mon attention sur ce mot, c'est justement la variété avec laquelle on explique cette métaphore. [...]
Il faudrait ainsi rapprocher l'idée de crépiter, de pétillement, et celle de bouillonnement |
Oui, bien sûr, il faut penser au feu, au crépitement des flammes. Un feu en pleine force, c'est un symbole de vie. Quand les flammes cessent de crépiter, le feu tire à sa fin.
C'est de crépiter qu'il faut rapprocher décrépit, et de rien d'autre.
Voici le début de l'article crépiter dans le TLF :
A.− [En rapport direct ou indirect avec le feu] Produire une suite rapide de bruits secs.
1. [Implique une combustion] Le bois crépite, des étincelles crépitent. La lanterne qui crépitait dans l'humidité de la nuit (Flaubert, Corresp.,1850, p. 222).De délicats papillons (...) crépitaient, brûlés, dans les calices des photophores (Colette, Naiss. jour,1928, p. 58):
D'autres [brasiers] crépitaient, lançaient des flammèches et des étincelles dans tous les sens, formaient des figures fugitives de soleils et de couronnes. Romains, Les Hommes de bonne volonté,Verdun, 1938, p. 133.
La décrépitude, c'est le commencement de la fin du feu, symboliquement parlant.
On voit par là que dans décrépit le préfixe de- a une valeur négative (= ce qui ne crépite plus), alors que dans l'anglais discrepancy, le préfixe dis- exprime la différence, la séparation (= crépitement différent).
Pour moi, cette dernière métaphore est moins évidente que la précédente. Au point que je me demande si discrepans est vraiment dérivé de crepare... Dans le premier exemple donné par Gaffiot (article discrepo), il est question de lyres non accordées. Les Latins avaient-ils l'oreille si peu musicale pour parler de "bruits secs" au lieu de "sons", aussi disharmonieux fussent-ils ? Quelle nuance de sens entre discrepo et dissono ? Pourquoi employer l'un plutôt que l'autre ? Peut-être que dissono signifie "jouer une fausse note" alors que discrepo signifie "jouer (en parlant de deux instruments jouant ensemble) deux notes qui ne s'accordent pas" ? |
|
|
|
 |
|







