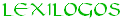| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
Qcumber
Inscrit le: 28 May 2006
Messages: 357
Lieu: France, région parisienne
|
 écrit le Monday 29 May 06, 21:45 écrit le Monday 29 May 06, 21:45 |
 |
|
J'ai rencontré ce mot une fois dans une lecture (oubliée), mais il n'est ni dans mon Petit Robert ni dans le Dictionnaire de l'ancien français de GREIMAS.
Ce terme désignait une tour ronde avec un toit conique (la tour en poivrière donc).
Le dérivé le plus connu est une roquette, qui est passé en anglais sous la forme rocket.
Pour moi roque est un cognat de l'anglais rook qui désigne la tour aux échecs.
Je pense aussi qu'il est présent dans certains patronymes (ex. Laroque) et toponymes (ex. Rocquencourt), avec peut-être parfois la forme roche (ex. Roche-Guyon).
À votre avis, quel pourrait être son étymon? |
|
|
|
 |
semensat
Inscrit le: 20 Aug 2005
Messages: 863
Lieu: vers Toulouse
|
 écrit le Monday 29 May 06, 22:01 écrit le Monday 29 May 06, 22:01 |
 |
|
"Rook" vient selon etymonline de l'ancien francais "roc" (source de roque ?), puis de l'arabe "rukhkh", enfin du persan "rukh" de sens inconnu, peut-être une imitation du sanscrit "rut" qui désigne la pièce d'échecs.
Dernière édition par semensat le Tuesday 30 May 06, 17:01; édité 1 fois |
|
|
|
 |
Maurice
Inscrit le: 25 May 2005
Messages: 435
Lieu: Hauts de Seine
|
 écrit le Tuesday 30 May 06, 11:16 écrit le Tuesday 30 May 06, 11:16 |
 |
|
| Qcumber a écrit: | | Ce terme désignait une tour ronde avec un toit conique (la tour en poivrière donc). |
Au jeu d'echec, roquer signifie déplacer simultanément le roi et une tour (d'une façon, bien précise), et d'après ton explication, je pense que le mot roquer vient de roque=tour |
|
|
|
 |
guillaume
Inscrit le: 14 Dec 2005
Messages: 669
Lieu: Istanbul, natif du Québec
|
 écrit le Tuesday 30 May 06, 12:23 écrit le Tuesday 30 May 06, 12:23 |
 |
|
Char est   rook en anglais. De même on a l'expression petit/grand roque en français, concernant le mouvement simultanée d'une tour et du roi. Cela viendrait du sanskrit ratha (char) via le persan et l'arabe rukh, alors que l'italien rook en anglais. De même on a l'expression petit/grand roque en français, concernant le mouvement simultanée d'une tour et du roi. Cela viendrait du sanskrit ratha (char) via le persan et l'arabe rukh, alors que l'italien  rocco (tour) a influencé le changement sémantique et l'adoption du mot tour en français. rocco (tour) a influencé le changement sémantique et l'adoption du mot tour en français.
Voir à ce sujet le mot échec sous la rubrique Mot du jour. |
|
|
|
 |
Qcumber
Inscrit le: 28 May 2006
Messages: 357
Lieu: France, région parisienne
|
 écrit le Tuesday 30 May 06, 12:38 écrit le Tuesday 30 May 06, 12:38 |
 |
|
Je continue ma recherche.
Le Petit Robert, qui n'a pas d'entrée pour une roque (il n'a que celle pour un roque), donne le germanique rokka "quenouille" comme étymon du diminutif une roquette.
The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots a l'entrée ruk- "filer avec une quenouille". En seraient dérivés le francique *rokka, le vieux-français rochet / rocquet "embout mis à la lance pour qu'elle ne blesse pas lors d'un tournois", le français rocambole, dont j'ignore le sens, ne connaisant que l'adjectif rocambolesque, et l'italien rócca "quenouille".
J'y ajouterais l'italien ròcca "1) forteresse, château fort; 2) roche; 3) tuyau de cheminée", l'italien rocchétto "bobine" et le vieux-français roche "château fort" expliqué par GREIMAS comme étant bâti sur un rocher.
GREIMAS cite aussi roc (1180) pour la tour des échecs, mais lui donne une origine arabo-persane sans pouvoir préciser l'étymon en dehors de l'espagnol roque.
Le dictionnaire de la Real Academia Española donne l'arabe rujj comme étymon de roque. La lettre J de leur transcription représente la fricative vélaire sourde [x].
La racine [rxx] رخ existe effectivement en arabe et signifie "mêler, emmêler; fouler, amollir". Le lexicographe a placé artificiellement sous la même racine le nom رخ [ruxx], qui est 1) celui de l'oiseau fabuleux Rokh et 2) celui de la tour des échecs, pl. [rixaxa(t)] رخخة.
L'étymon du terme arabe n'est pas donné. |
|
|
|
 |
Qcumber
Inscrit le: 28 May 2006
Messages: 357
Lieu: France, région parisienne
|
 écrit le Tuesday 30 May 06, 13:14 écrit le Tuesday 30 May 06, 13:14 |
 |
|
| guillaume a écrit: | | [i]Cela viendrait du sanskrit ratha (char) via le persan et l'arabe rukh |
(Oui, un roque designe le déplacement de la tour des échecs et a la même origine que l'anglais rook , qui désigne cette tour.)
Dans le jeu manichéen des échecs, chaque camp a deux ailes: celle du roi et celle du premier ministre (devenu la reine en Occident). Chaque aile comprend son chef et les quatre castes de la société indienne: les prêtres (le fou) représentés par un éléphant; les guerriers (le cavalier) représentés par un cheval; les marchands (la tour) représentés par une ville fortifiée résumée en une tour; les paysans (pion).
Je ne vois pas la filiation phonétique et celle sémantique du sanskrit rátha "chariot" (Monier-Williams 1899, 1981:865, 2) à l'arabe [ruxx] رخ "tour des échecs.
Pour la suite de la discussion, voir le Fil Origine et la comparaison des systèmes de castes. - [ Jean-Charles ] |
|
|
|
 |
Xavier
Animateur
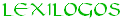
Inscrit le: 10 Nov 2004
Messages: 4087
Lieu: Μασσαλία, Prouvènço
|
 écrit le Wednesday 03 Oct 07, 20:35 écrit le Wednesday 03 Oct 07, 20:35 |
 |
|
Roquer, c'est un terme du jeu d'échec, d'après le TLF
| Citation: | | Déplacer de deux pas son roi vers la droite ou vers la gauche, suivant l'horizontale, et placer ensuite la tour vers laquelle il se dirige sur la case attenante au roi, en sautant par-dessus lui |
roquer, est aussi un terme utilisé au croquet.
| Citation: | | Au lieu de franchir un arceau, on peut chercher, avec sa boule, à atteindre une boule voisine. Si on la touche, on dit qu'on a roqué |
Je jouais au croquet quand j'étais enfant, dans le Perche : c'était le jeu "national" de notre famille : je devrais donc plutôt écrire le "jeu familial"...
Mais j'avais toujours dit "croquer" : j'ignore si c'est moi qui avait mal compris ou si mes grand-parents utilisaient ce terme.
Par exemple : "je vais te croquer". On doit donc dire : "je vais te roquer" (sous-entendu roquer ta boule)
le roque, c'est le coup par lequel on roque.
Ce verbe vient du nom, le roc, qui désignait autrefois la tour du jeu d'échec.
Ce terme a certainement été adopté par l'allusion au roc, comme une tour, forteresse construite sur un rocher afin qu'elle soit imprenable.
Cependant, le mot roc est emprunté à l'arabe رخ (rukh, rokh) avec une jota en finale.
Le mot arabe est emprunté au persan, pays d'origine du jeu d'échec.
En fait, cette tour devait être à l'origine un char. Et ce mot persan avait le sens de char, lui-même emprunté à une langue de l'Inde.
Outis pourra peut-être nous en dire plus. |
|
|
|
 |
felyrops
Inscrit le: 04 May 2007
Messages: 1143
Lieu: Sint-Niklaas (Belgique)
|
 écrit le Wednesday 03 Oct 07, 21:51 écrit le Wednesday 03 Oct 07, 21:51 |
 |
|
| En néerlandais ça s'appelle "roccade". |
|
|
|
 |
Outis
Animateur
Inscrit le: 07 Feb 2007
Messages: 3510
Lieu: Nissa
|
 écrit le Thursday 04 Oct 07, 8:52 écrit le Thursday 04 Oct 07, 8:52 |
 |
|
Il faut d'abord avoir inventé la roue …
Je vais commencer par des hypothèses personnelles. Il est possible que le premier déplacement à peu près uniforme basé sur un mouvement circulaire ait été la navigation à la rame, signifié par une racine *h₁er- qui serait à la base du thème *h₁r-eh₁- « rame » (skr ar-i-tṛ- « rameur », lat. rē-mus « rame », gr. ἐρέ-της [erétēs] « rameur », τρι-ήρης [triḗrēs] « trière »). Et c'est peut-être cette même racine qui a donné le nom de la rame terrestre, *h₁r-oth₂- « roue ».
Beekes pose *Hrot-h₂- avec une laryngale indéterminée à l'initiale.
Ce n'est pas très important, toutes les langues où ce nom de la roue est attesté perdent les laryngales initiales avant consonne et il suffit donc de poser *rot-h₂-, à l'origine du latin rota, du lituanien rātas « roue, cercle », de l'irlandais roth et de l'allemand Rad.
Dans beaucoup d'autres langues, le nom de la roue a été tiré d'une racine *kʷel- « circuler », d'où, avec ou sans redoublement, skr. ca-kr-a- « roue, disque », gr. κύ-κλ-ος [kúklos] « cercle, roue », angl. wheel. Le thème *rot-h₂- a cependant subsisté en indo-iranien en se spécialisant dans le nom du char de combat, l'arme par excellence de la culture eurindienne comme on s'en convaincra en lisant aussi bien le Mahābhārata indien que l'Iliade grecque ou la Táin Bó Cúalnge (Razzia des vaches de Cooley) irlandaise.
C'est ainsi que, l'indo-iranien ayant th₂ > th, ce char s'est appelé ratha- en sanskrit et raþa- en avestique (moyen-perse ras).
Le jeu d'échecs serait né en Inde aux alentours du VIe siècle (très imprécis) et il est probable que les pièces aient été nommées dans un prakrit non déterminé, expliquant ainsi l'évolution phonétique (on a en bengali roth) qui a donné ruḫ quand le nom de la tour (char) a été emprunté par le persan qui n'y a pas reconnu le char.
Dernière édition par Outis le Thursday 04 Oct 07, 14:36; édité 1 fois |
|
|
|
 |
semensat
Inscrit le: 20 Aug 2005
Messages: 863
Lieu: vers Toulouse
|
 écrit le Thursday 04 Oct 07, 8:56 écrit le Thursday 04 Oct 07, 8:56 |
 |
|
Le roque aux échecs est interdit dans plusieurs cas :
- s'il y a une ou des pièces entre le roi et la tour
- si le roi est en échec : on ne peut pas échapper à l'échec en roquant.
- si le roi ou la tour a déjà bougé au cours de la partie.
- si l'une des deux cases sur lesquelles le roi doit passer est en prise par une pièce adverse. Par exemple, dans cette position :

le roque est interdit.
On le note 0-0 pour le petit roque, et 0-0-0 pour le grand roque. |
|
|
|
 |
Outis
Animateur
Inscrit le: 07 Feb 2007
Messages: 3510
Lieu: Nissa
|
 écrit le Thursday 04 Oct 07, 15:31 écrit le Thursday 04 Oct 07, 15:31 |
 |
|
L'éthique échiquéenne précise que pour roquer on doit commencer par déplacer le roi : comme il parcourt deux cases, il n'y a aucun doute, alors que commencer par la tour serait ambigu …
J'ai vu une fois, il y a longtemps, un très brillant problème d'échecs dont la clef était un roque, entraînant un inévitable mat en deux coups, seule possibilité de gain de la partie. L'imagination des problémistes est quasiment sans limites … |
|
|
|
 |
Outis
Animateur
Inscrit le: 07 Feb 2007
Messages: 3510
Lieu: Nissa
|
 écrit le Thursday 04 Oct 07, 15:50 écrit le Thursday 04 Oct 07, 15:50 |
 |
|
Je viens de relire plus attentivement :
| Xavier a écrit: | … le roc, qui désignait autrefois la tour du jeu d'échec.
Ce terme a certainement été adopté par l'allusion au roc, comme une tour, forteresse construite sur un rocher afin qu'elle soit imprenable. |
C'est faire bon marché de ce qu'aux échecs la tour se déplace ! L'étymologie par le char de combat est autrement plus raisonnable …
Plus rapide que le pion mais moins maniable que le cavalier, sa puissance de pénétration des lignes adverses n'est dépassée que par la reine dont la grande latitude de mouvements rappelle peut-être que, dans l'épopée indienne, les chars des dieux (ou des héros particulièrement pieux) ne touchaient pas le sol …
Sur la distinction entre char et cavalier, je rappelle qu'on a mis très longtemps avant de monter sur les chevaux, pratique qui, pour être efficace, nécessitait l'invention du mors !
(c'est un aparté, pas un encouragement à entrer dans un hors-sujet …) |
|
|
|
 |
giòrss
Inscrit le: 02 Aug 2007
Messages: 2778
Lieu: Barge - Piemont
|
 écrit le Thursday 04 Oct 07, 16:28 écrit le Thursday 04 Oct 07, 16:28 |
 |
|
En italien, ça s'appelle  arrocco. arrocco. |
|
|
|
 |
semensat
Inscrit le: 20 Aug 2005
Messages: 863
Lieu: vers Toulouse
|
 écrit le Thursday 04 Oct 07, 17:24 écrit le Thursday 04 Oct 07, 17:24 |
 |
|
| Citation: | | J'ai vu une fois, il y a longtemps, un très brillant problème d'échecs dont la clef était un roque, entraînant un inévitable mat en deux coups, seule possibilité de gain de la partie. L'imagination des problémistes est quasiment sans limites … |
Effectivement, je le connais également. La position de départ est :
- blancs : Re1 Th1 Te4
- noirs : Rg3
Solution : << 1. 0-0 / Rh3 forcé ; 2. Tf3 mat >> |
|
|
|
 |
joachim

Inscrit le: 13 Jun 2006
Messages: 220
Lieu: Nord (avesnois)
|
 écrit le Friday 05 Oct 07, 10:45 écrit le Friday 05 Oct 07, 10:45 |
 |
|
Les grands joueurs d'échecs recommandent de roquer le plus tôt possible dans la partie, de façon à mettre les deux tours en correspondance, et aussi de plus facilement protéger le roi, isolé dans un coin du jeu.
Comme le dit Outis, les tours ne sont pas très maniables, du moins au début, mais si on réussit à les conserver, à la fin de partie le mat du roi adverse devient aisé. Pour moi, les deux tours sont plus importantes que la Dame toute seule. |
|
|
|
 |
|